News
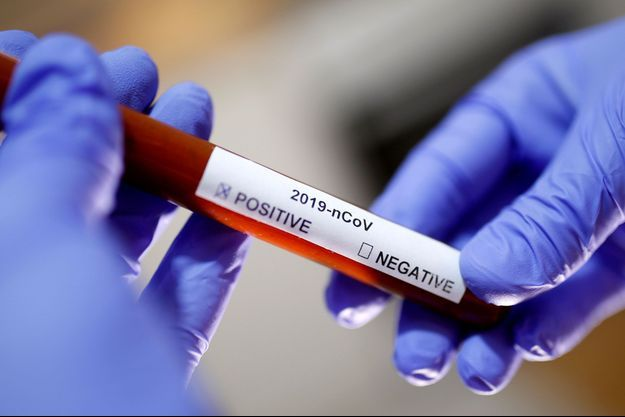
Veille Scientifique #9 : Données cliniques et virologiques des premiers cas de COVID-19 en Europe
Données cliniques et virologiques des premiers cas de COVID-19 en Europe : une série de cas
Référence de l'article original : Lescure FX, Bouadma L, Nguyen D et al. Clinical and virological data of the first cases of COVID-19 in Europe: a case series. Lancet Infect Dis. 2020 Mar 27.
Résumé proposé par Delphine Dupouy et Bastien Bregeard
Cet article traite d'une série de cas de cinq patients d'origine chinoise et revenant de Wuhan (Province de Hubei). L'agent pathogène à l'origine de la pneumonie dont ils sont atteints est le SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) et la maladie Covid-19 (coronavirus disease 2019). Ces cinq patients ont été admis à l'hôpital Bichât de Paris et à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux.
Les auteurs ont évalué la charge virale à partir d'échantillons nasopharyngés, de sang, d'urine et de selles, à 3 jours de leur hospitalisation puis tous les 2-3 jours jusqu'à leur sortie de l'hôpital.
La patiente 4 est l'épouse du patient 1, la patiente 5 est la fille du patient 3, le patient 2 n'a pas de lien de parenté avec les quatre autres patients.
Les patients 1 et 2 présentaient un niveau bénin de la maladie à leur admission avant une aggravation secondaire qui a conduit à leur admission en soins intensifs. Les patients 4 et 5 présentaient aussi un degré bénin de la maladie mais ont été diagnostiqués très tôt après l'infection. Le patient 3 gravement atteint a été directement admis en soins intensifs.
Sur la base d'avis d'experts et des données disponibles en janvier 2020, les auteurs ont considéré que le remdesivir (antiviral expérimental) pourrait être le médicament le plus pertinent pour le traitement du Covid-19 par voie intraveineuse avec une dose de 200mg puis une dose quotidienne d'entretien de 100mg pendant 10 jours.
Tous les patients ont été diagnostiqués le jour de leur admission sauf le patient 3 qui a été diagnostiqué seulement 3 jours après son admission.
Le patient 1 (31 ans) avait des symptômes pseudo grippaux et une radio pulmonaire normale avant d'être transféré en soins intensifs notamment pour des anomalies pulmonaires bilatérales dont une opacité en verre dépoli objectivée après un scanner thoracique. Il a reçu une dose de remdesivir puis ce traitement a dû être interrompu pour des complications sans gravité avant de pouvoir sortir asymptomatique du service 19 jours après son admission.
Le patient 2 (48 ans) a été admis à l'hôpital Pellegrin avec des symptômes pseudo grippaux avant d'être transféré en soins intensifs 2 jours plus tard avec une fièvre de plus de 38,5 degrés et une suspicion de septicémie. Le scanner thoracique a montré les mêmes détériorations que le patient 1. Il a reçu une dose de remdesivir puis un traitement d'entretien avant de sortir asymptomatique du service 21 après son admission.
Le patient 3 (80 ans) présentait un état déjà critique lors de son admission avec fièvre et diarrhée ainsi qu'une radio pulmonaire qui montrait une opacité alvéolaire bilatérale. Il ne remplissait pas la définition du Covid-19. Une insuffisance respiratoire aigüe a précipité son admission en soins intensifs de l'hôpital Bichât. Son état s'est ensuite détérioré par des atteintes rénales et hépatiques, un syndrome de détresse respiratoire aiguë et un choc septique. Le diagnostic de Covid-19 a alors pu être posé. Les différents traitements ainsi que l'administration de remdesivir ont dû être adaptés. Le scanner thoracique révélait les mêmes atteintes pulmonaires que les patients 1 et 2. Malgré une relance du remdesivir et des autres traitements, du fait de la gravité de la maladie, de la persistance d'une charge virale importante et d'une surinfection le patient 3 décède 20 jours après son hospitalisation.
La patiente 4 (30 ans) a été admise à l'hôpital Bichât avec des symptômes grippaux modérés et une radio pulmonaire normale. Malgré une toux persistante, son état s'est amélioré sans traitement spécifique. Elle est devenue asymptomatique 10 jours après son admission à l'hôpital est en est sortie encore 10 jours plus tard.
La patiente 5 (46 ans) présentait des symptômes légers, des douleurs à la gorge avec une toux sèche et une radiographie pulmonaire normale. Elle est devenue asymptomatique sans aucun traitement 7 jours après son admission avec une sortie 13 jours plus tard.
Pour les patients 4 et 5, la charge virale a été retrouvée dans les échantillons nasopharyngés et dans les selles mais pas dans les urines.
Chez les patients 1 et 2 la charge virale n'a été retrouvée que dans les échantillons nasopharyngés, sans lien de causalité entre l'évolution secondaire vers une aggravation de la maladie et l'augmentation de la charge virale. Le remdesivir leur a été administré par voie intraveineuse « alors que la charge virale avait déjà diminué en-dessous du seuil de détection ».
Pour le patient 3, la charge virale a diminué dans l'échantillon nasopharyngé après chaque administration intraveineuse de remdesivir mais son état à l'admission était déjà critique et de multiples complications secondaires ont entrainé son décès.
Pour les patients 1,2 4 et 5 la charge virale a diminué au fil du temps jusqu'à devenir négative entre les jours 9 et 14 de la maladie alors que pour le patient 3 « la détection du virus nasopharyngé a persisté jusqu'au décès ».
« Pour les patients 1 et 4, l'analyse de séquence du virus a montré que le virus se regroupait avec des virus de cas à Wuhan, Shenzhen (Chine), Californie (États-Unis), Australie et Taïwan, tandis que pour le patient 5, le virus se regroupait avec ceux de Chongqing (Chine) et Singapour. De plus, le très haut degré d'identité des séquences des patients 1 et 4 suppose un lien épidémiologique entre ces cas et la probabilité de transmission ».
Dans cette série de cas de cinq patients atteints du Covid-19 les auteurs ont observé et décrit trois types différents d'évolution cliniques et biologiques :
- Deux cas (1 et 2) bénins âgés de moins de 50 ans diagnostiqués précocement, ayant une charge virale élevée initiale dans les échantillons nasopharyngés avant de diminuer alors qu'ils présentaient une aggravation de l'atteinte des voies respiratoires, peut-être due à une réponse pro-inflammatoire excessive comme le suggèrent les auteurs.
- Deux jeunes patients (4 et 5) présentant des symptômes légers lors de leur admission avant de déclarer une pneumonie et de voir la maladie s'aggraver.
- Un patient âgé (3) dont l'état s'est rapidement dégradé avec une atteinte de plusieurs organes et une charge virale persistante dans les échantillons nasopharyngés mais aussi sanguins.
Afin d'améliorer l'efficacité des mesures de contrôle des infections, ces résultats montrent qu'il semblerait pertinent de combiner l'isolement des patients atteints de la maladie même faiblement, avec un dépistage. Les observations et mesures sur ce sujet amènent les auteurs à se demander si le Sars-CoV-2 aurait la capacité d'échapper à la réponse immunitaire en tant qu'inhibiteur des voies de signalisation de l'interféron. Ainsi, l'altération de sa réponse immunitaire pourrait avoir facilité les surinfections.
Les auteurs restent prudents dans l'analyse de ces données au regard du petit nombre de patients de cette série de cas.
« Il n'existe actuellement aucun traitement antiviral validé contrôlé de ces infections par le SRAS-CoV-2. Parmi les potentiels candidats, le remdesivir est un médicament antiviral (analogue nucléosidique) qui a une activité in vitro et in vivo à large spectre contre de nombreux virus à ARN, dont SRAS-CoV-2 » et qui a amélioré l'état pathologique des malades.
Par conséquent, sur la base de l'avis d'experts, l'utilisation de remdesivir est envisagée chez les tableaux de maladies graves.
A la date de cet article, deux essais contrôlés randomisés sont en cours en Chine pour évaluer le bénéfice clinique de ce traitement.
Sur la base de ces données, les auteurs ne peuvent toutefois tirer aucune conclusion sur la potentielle efficacité du remdesivir sur les infections à COVID-19. Ils envisagent cependant que « ces résultats contribueront à une meilleure compréhension de l'histoire naturelle de la maladie et participeront à faire avancer la mise en œuvre de stratégies de contrôle plus efficaces des infections ».
Vous pouvez retrouver ici le communiqué de l'INSERM daté du 2 Avril à propos de cette article : https://presse.inserm.fr/publication-dune-etude-dans-la-revue-the-lancet-infectious-diseases-portant-sur-les-cinq-premiers-cas-de-covid-19-identifies-en-france-et-en-europe-entre-le-24-et-le-29-janvier-2020/38931/
notes : François-Xavier LESCURE et Lila BOUADMA sont tous deux médecins à l'hôpital universitaire Bichât-Claude Bernard (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) à Paris.
Francois-Xavier LESCURE est professeur de médecine au service des maladies infectieuses et tropicales. Il est aussi médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale.
Lila BOUADMA est professeure de médecine à l'unité de soins intensifs des maladies infectieuses
Elle est aussi réanimatrice et membre du conseil scientifique Covid-19.
Duc NGUYEN est praticien hospitalier contractuel au service des maladies infectieuses et tropicales (unité maladies tropicales et du voyageur) à l'hôpital universitaire de Bordeaux.
Il est aussi médecin spécialiste en santé publique et en médecine sociale.
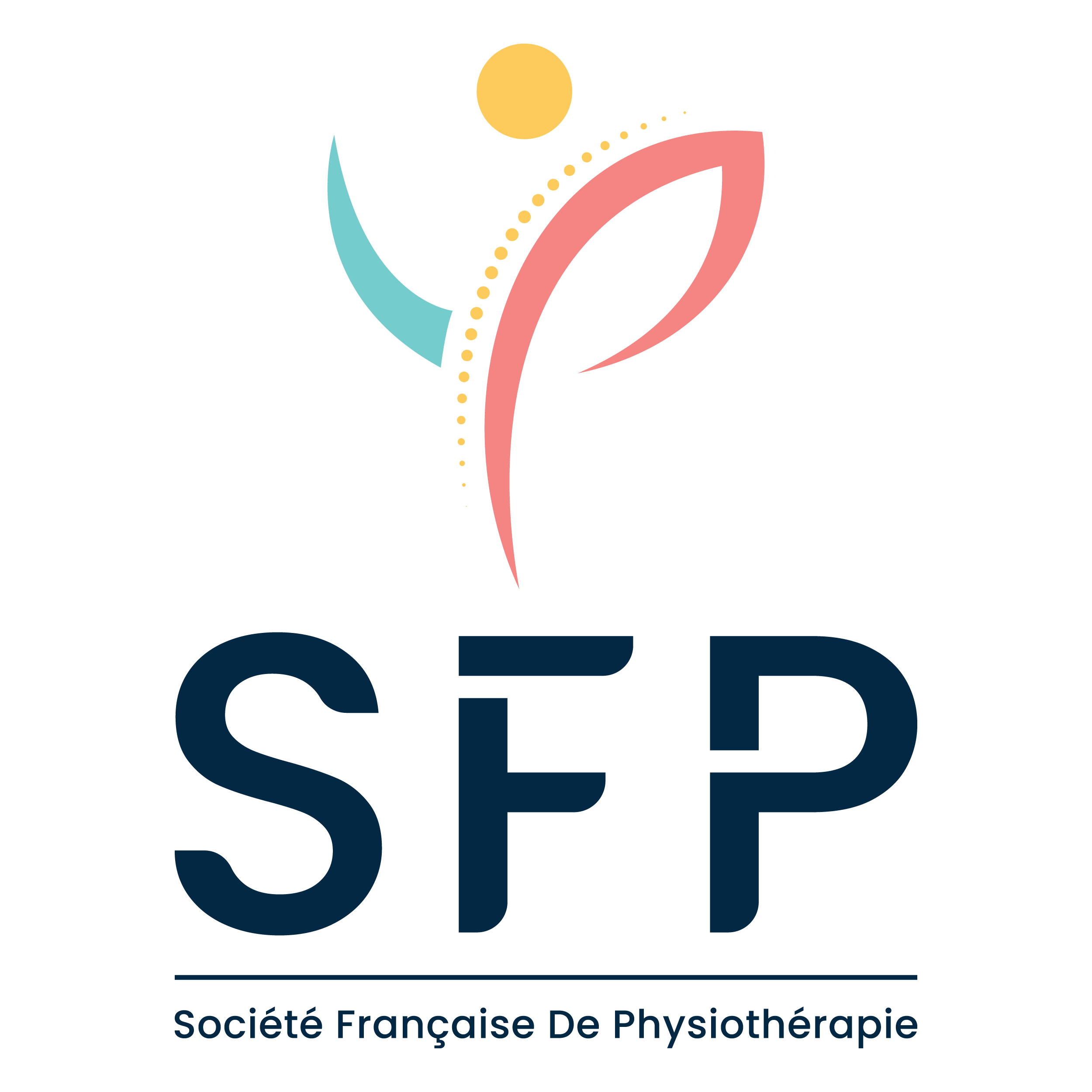

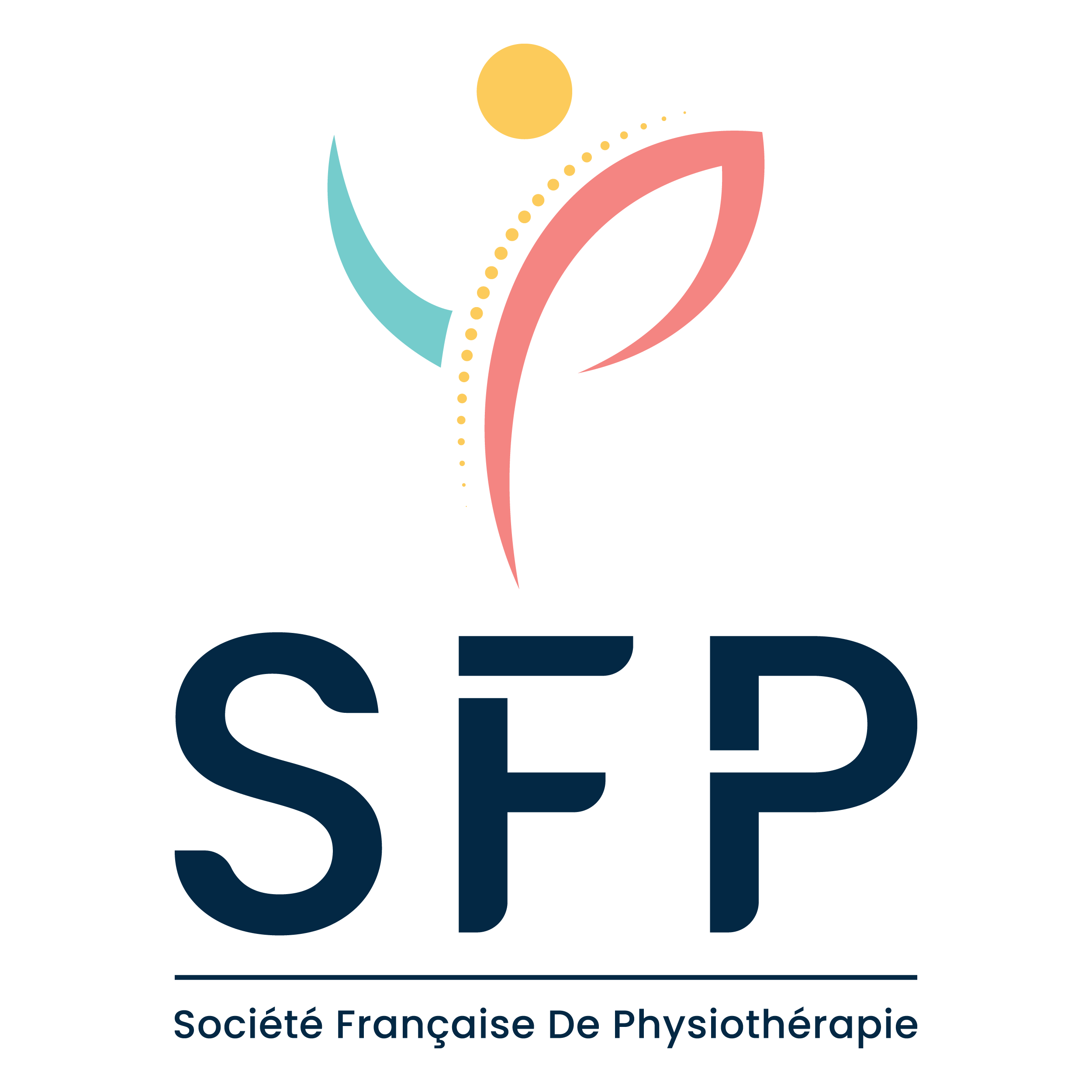










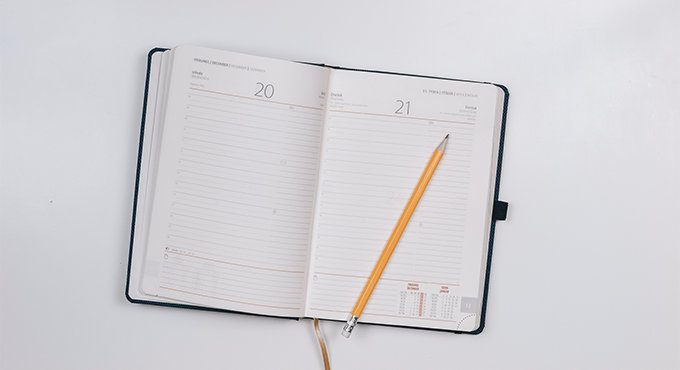
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.